La sûreté nucléaire internationale sur le vif
C'est pour rendre hommage à son ancien directeur Ulrich Schmocker, retraité depuis l'année dernière, que l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a organisé à Brugg un symposium international sur les défis actuels dans le domaine de la sûreté nucléaire. U. Schmocker a été acclamé par des applaudissements debout.

Consacré au thème «Current and Future Challenges for Nuclear Power Regulators», le symposium de Brugg a réuni le 20 janvier 2011 quelque 240 spécialistes à la Haute école Nord-Ouest de la Suisse. La manifestation a drainé un grand nombre de hauts représentants d'autorités de surveillance nationales et internationales ainsi que des spécialistes de centrales nucléaires et de l'industrie. Le symposium a été mené par André-Claude Lacoste, président de l'Autorité française de Sûreté Nucléaire (ASN).
Les conférenciers et les participants ont saisi l'occasion pour échanger des informations sur les défis actuels de la sûreté nucléaire mais aussi pour rendre hommage, par leur présence, au long et remarquable engagement d'Ulrich Schmocker. Celui-ci a commencé sa carrière comme physicien en 1976 à l'Institut Paul-Scherrer pour se faire engager, en 1981, à l'ancienne Division de la sécurité des installations nucléaires, devenue par la suite la Division principale de la Sécurité des Installations Nucléaires (DSN) et aujourd'hui, l'IFSN. Ayant repris la direction de l'autorité suisse de surveillance en 2002, U. Schmocker a cédé ses fonctions en août 2010 à son successeur Hans Wanner.
Au-delà des frontières nationales
Au cours de sa longue carrière, Ulrich Schmocker n'a pas seulement transformé la surveillance de la sûreté des installations nucléaires suisses en un principe de surveillance intégrée. Son engagement en la matière a rayonné bien au-delà des frontières de notre pays. Il a en effet travaillé dans bon nombre d'organismes internationaux en y exerçant une grande influence; ainsi, dans la Commission on Safety Standards de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dans la Western European Nuclear Regulators' Association (Wenra) ainsi que dans diverses commissions de l'OCDE.
L'amélioration, une tâche sur le long terme
Dans son discours de départ, U. Schmocker a redéfini une dernière fois la manière dont il a appréhendé son travail. L'énergie nucléaire est nécessaire pour maîtriser les défis de l'avenir, la sûreté devant ici rester la priorité absolue. Il ne suffit pas de conserver les acquis: la sûreté est une tâche sur le long terme qui doit rester axée sur une amélioration permanente.
En ce qui concerne les procédés de surveillance nationale, U. Schmocker a précisé qu'à défaut d'une voie royale, des chemins différents pouvaient être empruntés vers la réalisation de cet objectif. L'essentiel se résume en l'occurrence à concrétiser le but commun d'une protection permanente de l'homme et de l'environnement. La tâche d'une autorité de surveillance consiste à aider les exploitants d'installations nucléaires à percevoir leur responsabilité en tant que «Highly Reliable Organisation» (HRO) et à agir en conséquence.
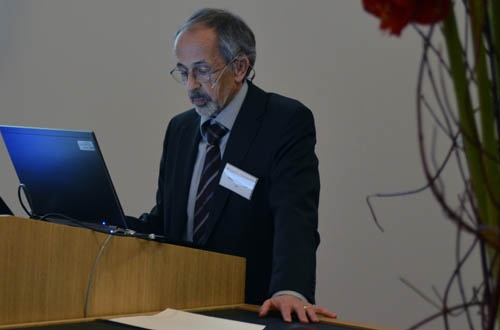
Transparence et communication
Le symposium de Brugg a abordé trois thèmes majeurs relevant du contexte international: la prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires existantes, la concrétisation des concepts d'évacuation des déchets radioactifs et les enseignements tirés des projets de construction de centrales nucléaires de dernière génération. Les exposés peuvent être consultés sur le site Web de l'IFSN: www.ensi.ch.
A titre de conclusion, Claude Lacoste a résumé l'essentiel comme suit: la coopération internationale doit être poursuivie et approfondie et l'harmonisation des prescriptions, poussée de l'avant. La transparence par rapport à l'opinion publique est devenue bien plus importante qu'auparavant. La communication doit donc faire partie intégrante du travail des autorités. Ou, pour reprendre les propos de Hans Wanner, nouveau directeur de l'IFSN: «Il ne suffit pas de dire qu'une installation est sûre. Nous devons aussi en expliquer les raisons de façon simplifiée mais correcte, et nous référer en même temps à l'opinion d'un ou de plusieurs experts indépendants. La formation de l'opinion publique dépend en effet de l'avis de spécialistes dignes de confiance.»
Source
M.S./P.V.