Fusion: contribution importante de la Suisse à Iter
La fusion entre dans une nouvelle phase avec le démarrage d’Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor). La Suisse y joue un rôle en vue avec la perspective de retombées scientifiques et industrielles importantes. Eclairage avec le Professeur Minh Quang Tran, patron de la contribution suisse, et Pierre Paris responsable du partenariat avec l’industrie.
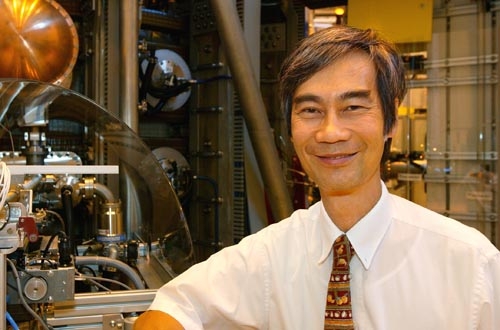
Quel est l'intérêt de la fusion dans une perspective énergétique?
Minh Quang Tran: La fusion, c'est la perspective d'une ressource énergétique très concentrée, abondante, durable et pratiquement sans impact direct sur la biosphère et sur le climat. La fusion permet également d'éviter un stockage géologique de déchets radioactifs à très longue durée de vie. Avec la fusion, un débat sociétal sur le développement durable et respectueux de l'environnement sera moins conflictuel qu'à présent!
La fusion nucléaire est elle encore une recherche fondamentale ou déjà une recherche énergétique?
MQT: C'est une recherche qui porte sur la physique des plasmas, sur les conditions de réalisation de la fusion contrôlée sur de longues périodes (plusieurs heures) ou mieux en continu, sur les matériaux et sur les technologies spécifiques à la fusion comme les couvertures tritigènes. Ceci dit, la réflexion sur les futures centrales produisant de l'électricité a déjà débuté. Elle porte sur l'étape qui suivra Iter. Cette étape, appelée Demo, verra la construction d'un premier réacteur de fusion produisant de l'électricité.
Quelles sont les principales difficultés? Où en est-on?
MQT: La maîtrise du plasma produisant beaucoup de réactions de fusion sur de très longues impulsions (supérieures à l'heure) et aussi la mise au point de matériaux entourant le plasma sont les principaux domaines de recherche. Des études de technologie sont nécessaires pour assurer que tous les composants et instruments satisfont les conditions nécessaires pour leur utilisation sur un réacteur.
Quelle est la place d'Iter dans les étapes du développement vers la fusion? Que va montrer Iter?
MQT: Iter va montrer la maîtrise de la fusion contrôlée à une puissance de 500 mégawatts thermiques. Mais ce n'est pas encore une centrale industrielle de démonstration. Il y aura d'ailleurs après Iter et avant la centrale de démonstration un prototype de démonstration, appelé «Demo» dans notre jargon.
Peut-on donner un délai pour atteindre la maturité industrielle (grandes séries) avec des réacteurs à fusion?
MQT: Honnêtement pas encore. On évoque le «Demo» pour dans une trentaine d'années et le vrai premier réacteur de fusion suivra. Le délai pour atteindre Demo dépend de la volonté politique, qui doit donner un signal fort pour que la communauté scientifique et industrielle (j'insiste sur l'importance du rôle de l'industrie!) puisse rassembler et maintenir des équipes compétentes afin de lancer les études sur Demo. Nous avons besoin d'une vision politique à long terme pour pouvoir former les nouvelles générations et assurer un soutien industriel.
Quelle est la contribution de la recherche suisse à Iter?
MQT: La Suisse, qui participe dans le cadre d'EURATOM pour environ 2,8% au financement du projet, contribue de manière significative au développement scientifique d'Iter. Notre contribution concerne plusieurs domaines où le CRPP est pionnier ou a acquis des connaissances spécifiques: tout d'abord à travers le tokamak TCV (Tokamak à configuration variable) et la simulation numérique des phénomènes physiques dans un plasma, nous contribuons à une préparation de l'exploitation scientifique d'Iter. Dans la technologie, nous disposons d'installations uniques au monde ou en Europe, comme l'installation de test des supraconducteurs SULTAN ou des gyrotrons, qui nous permettent de contribuer à la R &D des câbles supraconducteurs et du chauffage nécessaire à Iter. Les diagnostics sont un autre point fort du CRPP et là encore, nous travaillons pour Iter. «Last but not least», le CRPP étant une institution de l'EPFL, nous avons un important rôle de formation de la génération des physiciens et ingénieurs qui travailleront sur Iter.
Parlons de l'importance d'Iter pour l'industrie suisse. Dans quels domaines peut-elle contribuer aux fournitures de composants?
Pierre Paris: L'industrie suisse peut contribuer pratiquement dans tous les domaines. Dans certains domaines spécifiques où le CRPP est un laboratoire dont l'expertise est reconnue: c'est le cas dans l'étude des gros aimants supraconducteurs, les matériaux structurels spécifiques aux installations de fusion, l'étude et le test des tubes à hyperfréquences ou encore les antennes micro-ondes. L'industrie suisse dispose aussi de plusieurs domaines de grande compétence, par exemple dans les technologies de cryogénie, dans les secteurs de l'ingénierie et aussi dans le domaine des fournitures classiques, notamment dans la mécanique, les alimentations électriques, l'acquisition des données, l'électronique, la connectique et divers domaines des technologies de pointe. De manière plus restreinte, la Suisse pourrait aussi participer au génie civil dans des secteurs où certaines entreprises sont particulièrement spécialisées et reconnues au niveau européen.
L'industrie suisse est-elle bien placée?
PP: Oui. Elle l'a déjà prouvé avec l'expérience positive du projet européen JET à Culham (GB), la plus grande installation de fusion qui a précédé Iter. Alors que la Suisse participait à cette époque pour 3,5% au financement du projet, l'industrie suisse a obtenu de fait bien plus que ce prorata des commandes, elle en a reçu plus de 6% grâce à la qualité de ses prestations. Ensuite, il y a au moins une bonne trentaine d'entreprises potentiellement intéressées qui se sont annoncées pour participer à l'aventure Iter. Et d'autres peuvent encore le faire. Nous envisageons de présenter le projet Iter à travers la Suisse pour inciter les entreprises à participer à ce défi du XXIème siècle. Et par la suite, nous pensons rendre visite aux entreprises intéressées, pour trouver avec elles des potentialités de participation à Iter et à l'Approche Elargie, en fonction de leurs expériences, des expertises et de l'orientation qu'elles voudraient donner à leurs axes d'activités.
Quelles sont les conditions requises?
PP: Il y en a deux principales: La certification ISO et la volonté de participer à la conception des composants. Sur cette deuxième condition: beaucoup de composants ne pourront pas être conçus dans le détail par les concepteurs du projet Iter en ne laissant qu'un travail de réalisation à l'industrie. Avec un projet où tous les composants sont à la limite des connaissances et des contraintes (température, pression, radiations, etc.), la conception des composants devra impérativement se faire en partenariat avec les spécialistes de l'industrie. La condition pour atteindre les niveaux de qualité et de fiabilité nécessaires se fera en fait grâce à la concertation, je dirais même au partenariat entre les projeteurs et les réalisateurs industriels; c'est ainsi que les solutions les plus adaptées seront obtenues.
La participation à Iter est-elle réservée à de très grandes entreprises?
PP: Les grandes entreprises de l'industrie des machines ont bien sûr leur place. Mais les petites et moyennes aussi. Il y a des produits de niche, par exemple dans la connectique, les réalisations mécaniques, les appareillages et composants électriques, les capteurs, les composants pour le vide et la cryogénie où ces dernières ont un fort potentiel de contribution. Les entreprises qui ont par ailleurs réalisé ou participé à de grands projets peuvent également contribuer à la coordination des phases de la construction.
Avez-vous des préoccupations?
PP: Oui, une: depuis la participation à JET, il s'est écoulé beaucoup de temps et une partie de l?industrie des machines a réduit sa taille et a parfois disparu. Des spécialistes n'ont pas été remplacés et leur savoir faire est peut-être perdu. Il faudra quelque temps pour former les cadres et le personnel spécialisé nécessaires à la conception et à la réalisation des mandats amenant à la construction et à l'assemblage d'Iter. C'est aussi le rôle de notre institut de former les physiciens et ingénieurs qui désirent se lancer dans ce défi du début du siècle.
Quelles recommandations souhaitez-vous faire aux industriels?
PP: D'abord se faire connaître, annoncer leur intérêt, ensuite manifester leur envie de se profiler à la pointe d'une technologie et enfin savoir se frotter à d'autres partenaires en Suisse et à l'international parce que beaucoup de solutions ne pourront être trouvées que dans la mise en commun de compétences diverses et qu'il s'agira aussi de combler des lacunes de compétence. Toutes les disciplines industrielles sont touchées, la porte est ouverte à toute l'industrie suisse, Iter est un moteur d'avancées, voire de percées, technologiques et techniques comme il y en a peu. C'est une opportunité pour notre industrie.
Interview réalisée par Jean-François Dupont

Liaison Iter - Industrie
Pierre-Jean Paris
Swiss Industry Liaison Officer
Centre de Recherches en Physique des Plasmas (CRPP)
EPFL SB CRPP, Station 13
CH-1015 Lausanne
E-mail: pierre.paris@epfl.ch
Tél.: +41 (0)21 693 34 86
Fax: +41 (0)21 693 51 76